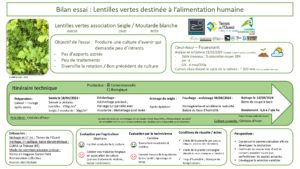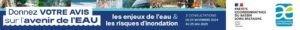Un nouveau succès pour l’essai de couverts sous maïs. Cette année, Philippe Jaouen de l’EARL de Kerfur expérimente le couvert sous maïs avec l’ETA Gouiffès en partenariat avec CCA et la CCPF.
L’année 2024 a été favorable à la pousse de l’herbe. L’EARL de Kerfur a testé pour vous le couvert sous maïs sous réserve que son développement n’impacte pas la croissance du maïs prévu en ensilage.
En juillet, l’ETA Gouiffès est venue biner et semer dans le maïs plusieurs mélanges de Ray Grass et de Trèfles (RGI, RGH, Trèfle Incarnat et Squarrosum) avec une bineuse 6 rangs. Au total, 8 kg/ha de trèfles et 25 kg/ha de ray gras ont été semés. Philippe Jaouen a choisi 3 parcelles proches du bâtiment afin de favoriser le pâturage au printemps prochain.

Vigilance : ne pas dépasser le stade 8 feuilles, météo sans pluie le jour du binage mais pluie dans les jours à suivre pour favoriser la germination.
Intérêt de la technique : la couverture du sol par l’herbe absorbe le surplus d’azote avant, pendant et après la récolte. Les fuites d’azote sont alors mieux maîtrisées.




Résultat : le couvert s’est bien développé malgré le manque de luminosité. Nous espérons une récolte avec une météo plus clémente pour éviter d’abîmer le couvert en place !


 Espace Membre
Espace Membre